LE FILTRE DIPLOMATIQUE
Au cours de précédents billets, j’ai montré que le droit international de l’asile actuellement en vigueur procédait, au moins en ce qui concerne la France, d’un malentendu extrême sur la portée future des obligations ratifiées en 1970. J’ai rendu compte également du travail réalisé par un historien canadien permettant de mieux comprendre les objectifs des acteurs intergouvernementaux à l’époque. Ces derniers, soucieux de créer un cadre universel pour le droit d’asile, se sont efforcés d’expédier les débats autour du nouveau protocole aux Nations-Unies.
L’interrogation résiduelle, et stratégique, demeure celle portant sur le caractère fortuit ou provoqué de l’erreur d’analyse et de prospective commise en réunion interministérielle, au moment des débats bureaucratiques portant sur l’adhésion de la France au protocole de Bellagio.
Trois hypothèses peuvent être émises : selon la première, le ministère des Affaires étrangères aurait disposé d’informations pertinentes sur l’avenir du droit d’asile ou aurait deviné les intentions de l’organisation internationale, mais aurait préféré en défendre une interprétation erronée auprès des autres administrations afin de privilégier ses objectifs bureaucratiques (thèse du filtre diplomatique), en l’espèce, la respectabilité ou l’image internationale de la France.
Selon la seconde, le Haut-Commissariat aux Réfugiés aurait favorisé une interprétation minimaliste et rassurante des obligations du protocole auprès des Etats occidentaux, y compris par le mensonge, et ce afin d’en hâter l’adhésion (thèse de l’organisation autonome).
Selon la dernière enfin, chaque acteur a travaillé de bonne foi et en parfaite transparence avec ses interlocuteurs, mais aucun ne disposait de prévisions réalistes quant à l’avenir du droit de l’asile et des mouvements migratoires associés, même à court terme (thèse des ingénus).
Mes recherches aux Archives diplomatiques de la Courneuve (93) ne permettent de répondre que partiellement à ces interrogations, et ne me poussent pas à ce stade à écarter résolument l’une de ces hypothèses.
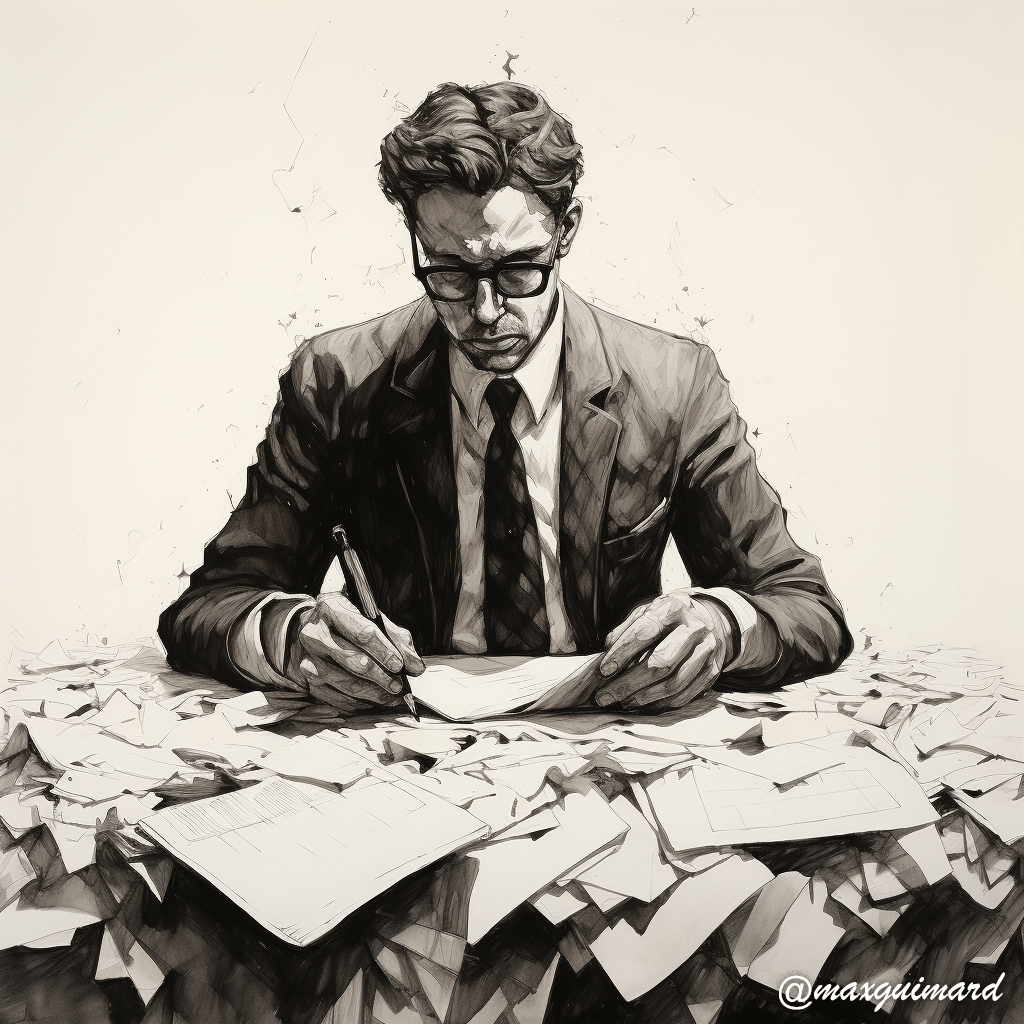
Le ministère des Affaires étrangères a-t-il disposé d’informations pertinentes sur l’avenir du droit d’asile et a-t-il préféré en défendre une interprétation erronée auprès des autres administrations afin de privilégier ses objectifs propres ?
La Direction des Nations-Unies du Quai d’Orsay, qui constitue le point de contact, à Paris, de la représentation française au Haut-Commissariat à Genève, formule clairement, en interne son objectif essentiel : ne pas étendre le droit d’asile « risquerait donc de nous exposer, dans la conjoncture actuelle, à des critiques, peut être fort acerbes, de la part du Tiers-monde et plus particulièrement des Etats africains ». Le directeur Guy de Lacharrière souhaite que les inconvénients « auxquels certains ministères paraissent fort sensibles » soient comparés à ceux qui, sur le plan politique, découleraient du maintien du statut discriminatoire actuel[i].
De façon peu surprenante donc, les coûts internationaux apparaissent prépondérants dans les estimations du ministère en charge des affaires étrangères, quand les coûts internes revêtent un intérêt bien supérieur pour les ministères qui ne se chargent que d’affaires internes. Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères pourrait bien avoir eu intérêt à forcer la main aux autres administrations.
Pour autant, au cours de mes recherches dans les fonds les plus indiqués, je n’ai remarqué aucun document faisant état d’analyses, au sein des services diplomatiques français, qui n’auraient pas été partagées en réunion interministérielle avec les autres ministères.
L’acteur principal des discussions au ministère des Affaires étrangères à Paris est le directeur des affaires consulaires (aujourd’hui DFAE), d’abord François Leduc, puis Gilbert de Chambrun. Mais la délégation française qui se rend au Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire est bien souvent composée de représentants d’autres ministères, dont celui des Affaires sociales et de l’Intérieur, principalement intéressés par les questions migratoires. Maurice Cantan, Sous-directeur de la Réglementation au ministère de l’Intérieur, et peu suspect de faiblesse sur les questions migratoires, et François Villey, administrateur civil hors classe, en sont les représentants de bon niveau. Dès 1966, le compte-rendu de ce dernier au ministre des affaires sociales explique qu’il « convient de ne pas faire une distinction qui serait artificielle entre les anciens et les nouveaux réfugiés », et que le « HCR ne peut intervenir qu’à titre transitoire dans les programmes de réinstallation »[ii]. Dès lors, le Quai d’Orsay ne se trouve pas dans une situation où il détient un monopole de l’information sur le protocole de Bellagio, au moment où il discute de sa ratification avec les autres administrations en 1967.
En revanche, il ne semble pas avoir ouvert de concertation avant d’engager le gouvernement français auprès du délégué du Haut-Commissaire en France[iii]. Ce point a une certaine importance car la coutume internationale, et le droit conventionnel, obligent les Etats signataires d’un accord de s’abstenir de bonne foi d’actes contraires au but du traité avant son entrée en vigueur[iv]. En l’espèce, le Quai d’Orsay semble avoir joué de ces circonstances, avec modération, pour presser les administrations réticentes ou sceptiques. Le ministre de l’Outre-mer Henri Rey écrit ainsi que :
« Le problème financier demeure entier. Les frais d’hébergement et de transport des réfugiés dans les DOM et TOM, ne sauraient en aucune façon incomber au budget de mon département, ni à ceux des territoires d’outre-mer […] l’accord que je suis amené à donner, pour tenir compte des raisons de politique internationale que vous invoquez, ne résoudra pas tous les problèmes que j’avais précédemment soulevés et qui peuvent se poser un jour sur le plan interne […] Puisqu’il ne vous apparait pas possible de retarder plus longtemps la ratification de ce Protocole, en faisant état de difficultés d’ordre interne, qui seraient difficilement reconnues et admises sur le plan international, je ne puis que m’incliner devant votre décision[v]».
Henri Rey, ministre de l’Outre-mer
Enfin, s’il n’y a eu aucune omission dans l’information du gouvernement, il est en revanche notable que de nombreux arguments apparaissent de façon répétée dans les conclusions des réunion interministérielles de l’année 1967, qui s’étendent sur plusieurs mois, ainsi que dans les rapports des commissions parlementaires, sans avoir jamais été formulés auparavant au sein du système des Nations-Unies.
Ainsi, l’affirmation déjà vue, selon laquelle « tout Etat reste souverain en matière d’entrée et de séjour des étrangers sur son territoire », constitue un plaidoyer ad hoc et non une garantie apportée par le Haut-Commissariat aux réfugiés. L’idée que le statut de réfugié délivré par l’OFPRA demeurerait subordonné à l’admission au séjour par le ministère de l’Intérieur, avancée lors des réunions d’arbitrage du 21 septembre et du 15 décembre 1967, est également une invention juridique interne, particulièrement surprenante au regard de l’objet même de la convention. Le Secrétaire général pour la Police, Jacques Aubert, n’est d’ailleurs pas dupe, puisque son accord à la levée de la réserve géographique n’est emporté qu’à la condition que « soient strictement fixés les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié[vi]».
De ces recherches sommaires, il ne résulte donc pas que le ministère des Affaires étrangères ait disposé d’informations qu’il aurait dissimulées auprès des autres administrations. En revanche, il semble qu’il ait défendu ses objectifs propres en recourant à la stratégie – somme toute assez classique – de mise devant le fait accompli, tout en avançant un plaidoyer juridique assez baroque, qui sera d’ailleurs démenti quelques années plus tard.
Pour autant, cette attitude a-t-elle constitué le critère déterminant de la décision française ? Autrement formulé, la France aurait-elle tout de même adhéré au protocole sans ces éléments ? Je tends à croire que oui, mais il est impossible de le savoir rigoureusement sans réaliser une comparaison entre chaque pays d’adhésion, et de rechercher les causes de l’adhésion des autres Etats au protocole de Bellagio, car il paraît peu probable que l’ensemble des chancelleries occidentales aient adopté le même comportement.
Par ailleurs, des développements plus approfondis sur le contexte politique de l’époque et sur le rôle du Haut-Commissariat aux réfugiés peuvent encore participer à éclaircir le mystère.
[à suivre…]
[i] MAE 517INVA/790, Note du 7 juin 1968 sur l’extension de la Convention de Genève de 1951
[ii] MAE 11POI/1/364, Note à l’attention du ministre des affaires sociales du 31 mai 1966
[iii] MAE 11POI/1/364, Lettre au Haut-Commissaire, 21 mars 1966
[iv] Article 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
[v] MAE 517INVA/790, Lettre 302/CABM du 4 août 1969 au ministre des Affaires étrangères
[vi] AN 19990260/25, Courrier du ministre de l’Intérieur pour la Police au ministre des affaires étrangères du 15 juin 1967